|
24/04/2005
|
|
|
En ce qui concerne l’Europe, l’attitude du Général de gaulle manifeste pendant la Ve République une grande continuité. Cette attitude semble inspirée par plusieurs principes.
Le général de Gaulle est très
attaché à l’Europe et il en parle souvent, avant comme après 1958[1].
Il souhaite une « Europe rassemblée », une « Europe unie ». Il considère
que l’Amérique est fille de l’Europe et il parle le 31 décembre 1960 de
« cette Europe rassemblée et l’Amérique sa fille ». Il estime que la
Russie fait partie de l’Europe depuis l’Atlantique jusqu’à l’Oural. Cette
formule ne date pas de la Ve République. Le général de Gaulle l’utilise,
semble-t-il, pour la première fois en public le 16 mars 1950 dans une
conférence de presse et il l’emploie à plusieurs reprises au temps du
RPF comme après 1958. Cette expression est
d’ailleurs singulière et significative : pour le général de Gaulle, les
frontières de l’Europe ne sont pas les frontières artificielles et
conjoncturelles de Yalta, mais les frontières définies par la géographie
que rappellent les manuels et les atlas.
Au temps du RPF, le Général de
Gaulle avait beaucoup parlé de l’organisation de l’Europe. Il s’était dès
1947 déclaré partisan d’une fédération européenne et avait préconisé un
vaste référendum des Européens libres (25 septembre 1949). Dans les
premiers temps du RPF, la terminologie du général de Gaulle n’est pas
extrêmement précise et, lorsqu’il parle de fédération, il est clair qu’il
songe à une organisation confédérale, respectant strictement
l’indépendance des Etats qui en feraient partie. C’est ainsi qu’il déclare
en juillet 52, à Saint-Maur, que la « confédération européenne est
peut-être la dernière chance de l’Occident ». Différents projets tendant à
créer une confédération européenne avaient été élaborés sous la IVe
République par des personnalités gaullistes. En 1950 puis en 1953, Michel
Debré avait présenté deux versions successives d’un « projet de pacte pour
une union d’Etats européens ». En décembre 1951 Gaston Palewski et le
Général Billotte avaient présenté au nom du groupe parlementaire RPF une
proposition de loi tendant à la création d’une confédération européenne. A
cet égard, le général de Gaulle développe exactement les mêmes idées sous
la Ve
Avant 1958, le général de Gaulle s’était vigoureusement opposé à toute organisation européenne fondée sur l’intégration et la supranationalité, et il est inutile de rappeler la vigueur de ses attaques contre la CECA et surtout contre la CED. Quant au Marché commun, le général de Gaulle – qui gardait alors le silence – n’avait pas en 1957 dénoncé les méfaits du traité de Rome, mais Michel Debré avait fait le 19 juillet 1957 un discourt long et passionné contre le Marché commun qu’il avait terminé en s’écriant : « Ce que l’on vous propose, c’est la disparition de la Nation. » L’inquiétude était donc vive dans le « camp européen » lorsque le général de Gaulle revint au pouvoir en 1958 et lorsqu’il prit en 1959 Michel Debré comme Premier ministre. On trouve l’écho de cette inquiétude dans le livre de Paul Raynaud, La politique étrangère du gaullisme[2]. Mais, contrairement à ce que redoutaient les adversaires de la politique étrangère gaulliste, la France ne se retire pas du Marché commun. Au contraire, sous l’influence personnelle du général de Gaulle, la France s’engage irréversiblement, dès le 1er janvier 1959, dans la voie du Marché commun et c’est à la suite de ses interventions pressentes et de « débats dramatiques », selon l’expression dont il se sert lui-même dans ses mémoires d’espoir (P.198), que le marché commun a été étendu à l’agriculture à partir de 1962[3]. Il n’est donc pas faux de dire que le général de Gaulle a été, dans le domaine économique, un ferme partisan de la construction européenne et que, sans son action personnelle, l’extension du Marché commun à l’agriculture serait longtemps restée problématique. Pourquoi cet apparent revirement ? Sans doute faut-il mentionner une fois de plus le pragmatisme du général de Gaulle et son sens aigu des évolutions irréversibles[4]. Mais il faut ajouter, d’une façon plus précise, que les mesures financières de décembre 1958 et la politique d’austérité découlant du plan Pinay-Rueff permettaient à la France de renoncer au protectionnisme et de s’engager dans le Marché commun. Or il est certainement beaucoup plus conforme à la philosophie politique du général de Gaulle d’engager, avec de solides chances de succès, la France dans le jeu de la concurrence internationale, que de pratiquer une politique de protection douanière, de contingentements et de prix artificiels. On aurait donc tort de considérer comme une sorte de palinodie ou comme une brusque conversion l’attitude du général de Gaulle à l’égard du marché commun à partir de 1958. Tout se passe plutôt comme s’il avait estimé que, le général de Gaulle étant revenu au pouvoir, l’économie française rénovée serait assez solide pour supporter l’épreuve du Marché commun et que la France serait assez forte pour refuser catégoriquement toute forme d’intégration nationale.
Quoi qu’il en soit, cette Europe des Etats, pour le général de Gaulle, doit être soustraite à l’influence prépondérante des Etats-Unis. Sans doute, compte-t-il – et n’a-t-il pas apparemment jamais cessé de compter – sur les Etats-Unis pour assurer la défense de l’Europe, mais il est fondamentalement hostile à toute formule de force multilatérale et d’intégration militaire. Il affirme sans ambiguïté le 25 avril 1960 devant le Congrès des Etats-Unis que la France a choisi d’être « du côté des peuples libres[5] » et rien ne permet de penser qu’il ait à cet égard le moins du monde changé d’avis. Le général de Gaulle n’est donc partisan ni d’une Europe atlantique, soumises aux Etats-Unis, ni d’une Europe-troisième force qui constituerait un troisième bloc entre les Etats-Unis et la Russie. Il est, en définitive, partisan d’une Europe indépendante, à l’abri du parapluie atomique américain, une Europe constituée d’Etats indépendants, et, grâce à la politique que seule peut mener la France, s’étendant progressivement vers les pays de l’Est. L’Europe ne peut être l’Europe sans la France : « Bref, il nous parait essentiel que l’Europe soit l’Europe et que la France soit la France » (19 avril 1963). Ou encore : « La France, parce qu’elle est la France, doit mener au milieu du monde une politique qui soit mondiale ». Bref, la politique européenne, pour le général de Gaulle, n’est pas une fin en soi, elle n’est qu’un aspect d’une politique mondiale, un moyen pour la France d’acquérir le rang qui doit être le sien et d’affirmer son indépendance. Pour réaliser cette politique européenne et mondiale, le général de Gaulle compte d’avantage sur l’Allemagne que sur l’Angleterre. Il entretient des relations étroites avec Adenauer et conclu en janvier 63 un traité avec l’Allemagne, qui ne donnera pas les résultats escomptés. En revanche, il oppose à deux reprises un veto à la candidature britannique au Marché commun : le 14 janvier 1963 il répond non à la candidature présentée par MacMillan ; le 16 mai 1967, il répond non à la candidature présentée par Wilson. Selon Alfred Grosser, dont le livre la politique extérieure de la Ve République est dans l’ensemble sévère, ce choix de l’Allemagne aux dépend de l’Angleterre pour tenter de pratiquer une politique d’indépendance constituerait une des erreurs majeures qu’aurait commises le général de Gaulle. Mais avant de porter des jugements de valeur, sans doute est-il nécessaire de fournir quelques précisions complémentaires sur l’attitude du général de Gaulle envers la construction de l’Europe et les institutions européennes, envers l’Allemagne et l’Angleterre. Dans les deux premières années de la Ve République, l’Algérie est le problème majeur et le général de Gaulle n’a guère le loisir d’élaborer un plan d’ensemble concernant l’organisation de l’Europe. Il le fait en 1960, l’année où accèdent à l’indépendance les anciennes colonies françaises d’Afrique noire. « Suivant ma méthode, écrit le général de Gaulle dans ses Mémoires d’espoir, je crois bon de saisir l’opinion » (p. 206). Après s’être entretenu pendant les mois d’été avec le chancelier Adenauer, avec le président du Conseil italien Fanfani et avec le Premier ministre des Pays-Bas, il expose le 5 septembre 1960 dans une conférence de presse son plan pour « construire l’Europe » : il faut « procéder, non pas suivant des rêves mais d’après des réalités ». Or les réalités de l’Europe, ce sont des Etats. Pour le général de Gaulle les organismes « plus ou moins extranationaux » n’ont pas et ne peuvent pas avoir « d’autorité et par conséquent d’efficacité politique ». Il propose donc : une concertation régulière et organisée des gouvernements européens ; la délibération périodique d’une assemblée formée par les délégués des parlement nationaux ; enfin « un solennel référendum européen de manière à donner à ce démarrage de l’Europe le caractère d’adhésion et de conviction populaire qui lui est indispensable » (5 septembre 1960). Ce projet n’est pas immédiatement rejeté par les partenaires de la France. Il est précisé par la Commission présidée par Christian Fouchet et donne naissance au « plan Fouchet » qui est conforme aux principes mentionnés le 5 septembre 1960 par le général de gaulle. Le « plan Fouchet » prévoyait un « traité établissant une union d’Etats », avec un Conseil réunissant les chefs de gouvernement, une Assemblée parlementaire européenne et une Commission politique européenne. Ce plan est mal accueilli par les partisans de l’Europe supranationale, notamment par les gouvernements de Belgique et des Pays-Bas qui avancent deux critiques, à dire vrai peu conciliables : le plan français ne porte aucune atteintes aux prérogatives nationales. Or, comme le dit le ministre belge Spaak le 10 janvier 1962 : « L’Europe sera supranationale ou ne sera pas » ; d’autre part, le plan français écarte la Grande-Bretagne et on ne peut construire l’Europe sans les Anglais. Ce « préalable anglais » n’était peut-être pas parfaitement cohérent avec le premier argument car les Anglais n’ont jamais passé pour être de chauds partisans de la supranationalité et on peut penser qu’ils auraient manifesté très peu d’enthousiasme pour une Europe intégrée selon les principes supranationaux. Quoi qu’il en soit, le plan français se heurte à de très vives objections. Le 5 février 1962, le général de Gaulle lance un nouvel appel pour « faire sortir l’Union de l’Europe du domaine de l’idéologie et de la technocratie pour la faire entrer dans celui de la réalité, c’est-à-dire de la politique ». Mais, le 17 avril 1962, les gouvernements belge et hollandais opposent un veto au plan français, après avoir une nouvelle fois soulevé le préalable anglais. Un mois plus tard, le 15 mai 1962, dans la première conférence de presse consécutive à la constitution du gouvernement Pompidou, le général de Gaulle, devant tous les ministres, y compris les ministres MRP, notamment Maurice Schumann et Pflimlin, expose une nouvelle fois ses idées sur l’Europe. Il affirme : »Il ne peut pas à l’heure actuelle y avoir d’autre Europe que celle des Etats ». Il s’oppose catégoriquement à la supranationalité : « Dante, Goethe, Chateaubriand […] n’auraient pas beaucoup servi s’ils avaient été des apatrides et s’ils avaient pensé, écrit en quelque esperanto ou volapük intégrés ». Il termine par une allusion antiaméricaine (« Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen ») et affirme qu’il est nécessaire de procéder à une révision de l’Otan. Douloureusement affectés par ces propos et notamment par l’allusion au « volapük » qu’ils semblent avoir considéré comme injurieuse, les ministres MRP décident de quitter le gouvernement. Le 12 novembre 1952, le général de Gaulle avait parlé dans les mêmes termes du volapük et de l’esperanto : « On n’est pas un Européen si l’on est un apatride. Chateaubriand, Goethe, Byron, Tolstoï n’auraient rien valu du tout en volapük ou en esperanto ». En 1963, le général de Gaulle parle beaucoup de l’Europe[6] et dénonce en toute circonstance le danger d’une Europe dominée par les Etats-Unis – ce qui ne manquerait pas de se produire si la Grande-Bretagne entrait dans le Marché commun. Le 23 juillet 1964 le général de Gaulle parle d’une « Europe européenne » et il précise le 22 novembre 1964, après son retour d’Amérique latine, ce qu’il entend par là : "La construction d’une Europe européenne, autrement dit indépendante, puissante et influente au sein du monde de la liberté. » Au début de 1965, il précise que la constitution de cette Europe indépendante, de l’Atlantique à l’Oural permettrait de résoudre le problème allemand et d’envisager la réunification des deux Allemagnes. Le 30 juin 1965 : crise de Bruxelles[7] ; les règlements agricoles qui auraient dû être adoptés à cette date n’étant pas établis, la France suspend les négociations de Bruxelles et interrompt sa participation aux institutions du Marché commun. Cette crise suscite de violentes attaques de la part des partisans de l’intégration européenne qui taxent le général de Gaulle de nationalisme borné. On retrouve l’écho de ces critiques dans la campagne électorale de Jean Lecanuet avant les élections présidentielles où le général de Gaulle est mis en ballottage le 5 décembre 1965. Durant toute cette période, le général de Gaulle s’exprime sans le moindre souci d’amabilité à l’égard des « Européens ». Le 10 juin 1965, il déclare lors d’une réception à l’Elysée : « On peut faire des discours sur l’Europe supranationale. Ce n’est pas difficile : il est facile d’être Jean-foutre » (A. Passeron, II, P. 305). Cette appellation vigoureuse n’est pas des plus appréciées que la phrase de 1962 sur le volapük. Le 9 septembre 1965 le général de Gaulle critique la commission de Bruxelles qu’il qualifie de « technocratie en majeur partie étrangère » et il parle de « quelque aréopage technocratique apatride et irresponsables ». Il critique la CECA, l’Euratom, le traité de Rome et assure une nouvelle fois que seule une Europe de l’Atlantique à l’Oural respectant la souveraineté peut régler le problème allemand et assurer une aide efficace aux pays sous-développés. Le 14 décembre 1965, entre le premier et le second tour de l’élection présidentielle, le général de Gaulle répond aux questions d Michel Droit sur l’Europe. Le général de Gaulle est en verve et il réponds : « Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant : l’Europe, l’Europe, l’Europe, mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien… ». Un peu plus tard il parle de l’Europe supranationale : « Alors vous en avez qui crient : Mais l’Europe, l’Europe supranationale ! Il n’y a qu’à mettre tout cela ensemble, il n’y a qu’à fondre tout cela ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c’est commode et quelquefois c’est assez séduisant, on va sur des chimères, on va sur des mythes. Mais il y a des réalités, et les réalités ne se traitent pas comme cela ». Le général de Gaulle répète que l’Europe ne peut être fondée que sur la coopération entre Etats. En janvier 1966, la crise du Marché commun s’achève par un compromis. Les 5 partenaires de la France restant fidèles au principe de la majorité pour certaines décisions et la France y restant hostile, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Luns, trouve une formule subtile : « Lorsque dans le cas d’une décision susceptible d’être prise à la majorité sur proposition de la commission, des intérêts très importants d’un ou plusieurs partenaires seront en jeu, les membres du Conseil s’efforceront dans un délai raisonnable de parvenir à des solutions qui pourront être adoptées par tous les membres du Conseil dans le respect de leurs intérêts et de ceux de la communauté ». Bref on ne prendrait pas de décisions à la majorité sans avoir de bonnes raisons de penser qu’elles pourront être adoptées unanimement. Après cette crise, la France réintègre le Marché commun et on assiste depuis cette date à une certaine « relance européenne » sur le plan économique sinon sur le plan politiquer. Entre 1965 et 1969, le général de Gaulle n’ajoute rien de bien nouveau en ce qui concerne l’Europe. Dans sa conférence de presse du 28 octobre 1966 – peu de temps après le discours de Pnom Penh -, il affirme qu’il n’a jamais cessé de travailler pour l’Europe, mais une Europe libérée de « l’hégémonie américaine ». Le 1er décembre 1966, recevant Kossyguine à Paris, il déclare : « Y aurait-il une guerre du Vietnam si l’Europe était unie ? » Il semble bien en fin de compte que le général de Gaulle, en ce qui concerne l’Europe, ait évolué depuis la fin de la guerre : il rêve alors – c’est du moins ce qui apparaît dans le tome III des Mémoires de guerre – d’une Europe troisième force, qui puisse un jour « être l’arbitre entre les deux camps ». Sous la Ve République, il prend acte de la détente et mise sur la dissolution des blocs : « Il n’est point, à la longue, de régime qui puisse tenir contre les volontés nationales », écrivait-il déjà dans le tome III des Mémoires de guerre.
[1] Cf. l’ouvrage particulièrement volumineux d’Edmond Jouve, le Général de Gaulle et la construction de l’Europe (1967) [2] Julliard, 1964 [3] Cf. les « marathons agricoles » de janvier 1962, décembre 1963 et décembre 1964, ainsi que la crise de 1965. [4] C’est ainsi qu’il déclare le 12 juin 1963 à Angoulême : « Le Marché commun se fera progressivement, c’est maintenant une chose irréversible. » [5] Le 25 avril 1960, le général de Gaulle déclare devant le Congrès des Etats-Unis : « Si, matériellement parlant, la balance peut sembler égale entre les deux camps qui divisent l’univers, moralement elle ne l’est pas. La France, pour sa part, a choisi ; elle a choisi d’être du ôté des peuples libres, elle a choisi d’y être avec vous ». [6] Selon Edmond Jouve, c’est l’année où les thèmes européens tiennent, de 1958 à 1966, le plus de place dans les déclarations du général de Gaulle. [7] Selon le titre du livre de John Newhouse publié par la Fondation dans la collection « Nations et alliances ». |

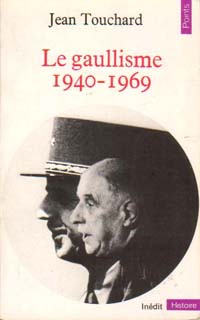
 L’avènement
de l’Union soviétique et la guerre froide n’ont rien changé aux frontières
de l’Europe telles que les avait apprises le jeune Charles de Gaulle
lorsqu’il était écolier. Mais cette formule qui irrite si vivement les
plus ardents tenants de l’intégration européenne dans le cadre de l’Europe
occidentale n’était assurément pas faite pour plaire aux Soviétiques car –
s’il fallait la prendre à la lettre – elle signifierait que la Sibérie,
les républiques socialistes d’Asie n’appartiennent pas en fait à l’URSS
mais au monde mystérieux et un peu inquiétant que peuplent les Jaunes,
comme si l’Oural constituait à cet égard une frontière et un rempart.
L’avènement
de l’Union soviétique et la guerre froide n’ont rien changé aux frontières
de l’Europe telles que les avait apprises le jeune Charles de Gaulle
lorsqu’il était écolier. Mais cette formule qui irrite si vivement les
plus ardents tenants de l’intégration européenne dans le cadre de l’Europe
occidentale n’était assurément pas faite pour plaire aux Soviétiques car –
s’il fallait la prendre à la lettre – elle signifierait que la Sibérie,
les républiques socialistes d’Asie n’appartiennent pas en fait à l’URSS
mais au monde mystérieux et un peu inquiétant que peuplent les Jaunes,
comme si l’Oural constituait à cet égard une frontière et un rempart. République que sous la Ive, et le «
République que sous la Ive, et le «  Le
général de Gaulle en effet n’est pas moins hostile à la supranationalité
qu’il l’était avant 1958. Il n’a jamais employé publiquement l’expression
« Europe des patries », mais son Premier ministre, Michel Debré, se
déclare le 15 janvier 1959 devant l’Assemblée nationale partisan de
« l’Europe des patries et de la liberté ». L’expression « Europe des
patries » est utilisée par de nombreuses personnalités gaullistes,
notamment
Le
général de Gaulle en effet n’est pas moins hostile à la supranationalité
qu’il l’était avant 1958. Il n’a jamais employé publiquement l’expression
« Europe des patries », mais son Premier ministre, Michel Debré, se
déclare le 15 janvier 1959 devant l’Assemblée nationale partisan de
« l’Europe des patries et de la liberté ». L’expression « Europe des
patries » est utilisée par de nombreuses personnalités gaullistes,
notamment