|
|
Robert Marjolin,
une vie au service
de l’oligarchie financière anglo-américaine
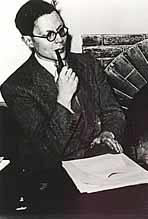 L’économiste
Robert Marjolin constitue l’un des meilleurs fils rouges que nous
possédons pour suivre les politiques promues par l’oligarchie financière
anglo-américaine et ses alliés continentaux, depuis les années trente
jusqu’à sa mort en 1986. L’économiste
Robert Marjolin constitue l’un des meilleurs fils rouges que nous
possédons pour suivre les politiques promues par l’oligarchie financière
anglo-américaine et ses alliés continentaux, depuis les années trente
jusqu’à sa mort en 1986.
Issu d’une famille très modeste, ce sont
les deux représentants de la Fondation Rockefeller en France, Célestin
Bouglé, directeur de l’Ecole normale supérieure et fondateur du Centre
de documentation sociale, et Charles Rist, économiste de renom
international, sous-gouverneur de la Banque de France avant la guerre et
fondateur de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES),
qui l’ont promu à un rôle de premier plan sur la scène internationale.
C’est alors qu’il passait son oral à la
Sorbonne que Bouglé «repère» Marjolin. En 1932, il lui obtient une
bourse aux Etats-Unis, à la Fondation Rockefeller, pour étudier les
rapports entre la culture et la personnalité. En 1933, Bouglé présente
Marjolin à Rist qui en fera son principal collaborateur à l’IRES.
Ses liens avec la Fondation Rockefeller
propulsent Marjolin dans cet univers glauque d’avant-guerre qui fournira
ses troupes à la Révolution nationale de Vichy. Cependant, tous n’ont
pas collaboré avec les nazis, certains finissant par choisir, in
extremis, d’entrer en résistance avec Churchill, lorsqu’ils se sont
aperçus qu’Hitler avait décidé de s’attaquer à l’Europe de l’Ouest avant
de s’en prendre à l’Union soviétique.
Bien que se réclamant du socialisme –
Marjolin fut chargé de mission auprès de Léon Blum en 1936 dans le
premier gouvernement du Front populaire – il pratique le grand écart
entre ces idées et les groupes économiques les plus libéraux, voire même
avec les milieux planistes inspirés par le néo-fasciste belge Henri de
Man.
En tant que principal collaborateur à
l’IRES, Marjolin faisait de fréquents voyages à Londres pour travailler
avec la London School of Economics, où la Fondation Rockefeller
finançait déjà les économistes qui allaient fonder en 1947 l’infâme
Société du Mont-Pèlerin, Lionel Robbins et Friedrich von Hayek. Dans son
autobiographie*, Marjolin dira tout le bien qu’il pense du «Reform Club»
et de ces milieux où il «retrouvait d’excellents amis anglais» dont
«Lionel Robbins».
Marjolin sera aussi de ceux qui fondèrent
l’organisation qui a préfiguré l’ultra-libérale Société du Mont-Pèlerin.
Dès 1938, «Le colloque Walter Lippmann», organisé par le philosophe et
économiste Louis Rougier, donna lieu à la création du Centre
international d’études pour la rénovation du libéralisme. Lippman, un
publiciste américain, venait de publier un livre, The Good Society,
qui avait fait fureur, renvoyant dos à dos socialisme et fascisme pour
ce qui était du contrôle des moyens de production, mais proposant
d’encadrer le libéralisme économique par un cadre juridique et policier
tout aussi autoritaire. Sur les vingt-six personnalités présentes à la
fondation de la Société du Mont-Pèlerin, en Suisse, en 1947, seize, dont
les principales, avaient déjà participé à ce colloque d’avant-guerre à
Paris, dont : Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Walter Lippmann, M.
Polany, et Walter Röpke. Parmi les Français, outre Louis Rougier, on
trouvait sans surprise Raymond Aron, Robert Marjolin et Jacques Rueff
qui, plus tard, travaillera avec de Gaulle. Notons que l’existence de ce
colloque fut longtemps occultée par les fondateurs de la Société du
Mont-Pèlerin en raison des liens très étroits entretenus par Louis
Rougier avec le régime de Vichy. Lionel Robbins aurait ainsi émis son
veto à la participation de Louis Rougier à la première réunion de
Société du Mont-Pèlerin, en avril 1947, et ce n’est que dix ans plus
tard, à Saint-Moritz, que Rougier réintégrera la Société, avec le
soutien remarqué de Friedrich von Hayek.
Marjolin déclare, dans son
autobiographie, qu’«il y a trois noms auxquels (sa) pensée s’accroche
parmi (ses) contemporains» d’avant-guerre, «Raymond Aron, Eric
Weil et Alexandre Kojève. Je leur dois, dit-il, une grande partie
de ce que je pense, de ce que je suis. Il existait entre nous, malgré
nos divergences, une unité profonde dans la façon dont nous jugions le
monde qui nous entourait et le mouvement de l’histoire». C’est
également à cette époque qu’il fit connaissance d’Olivier Wormser à qui
une grande amitié le liera jusqu'à sa mort. Marjolin participa au
séminaire sur Hegel donné par Kojève à l’Ecole pratique des Hautes
Etudes et fera entrer l’émigré franco-russe au ministère de l’Economie
en 1945.
Notons enfin que, bien que Marjolin, tout
comme Raymond Aron, aient participé à la résistance contre le nazisme,
ils ont aussi collaboré avec les milieux qui suivirent le maréchal
Pétain jusqu’au bout. Marjolin dit lui-même avoir été «un temps séduit»
par le groupe du 9 juillet (1934), qui rassembla les «planistes» de tous
bords autour d’un programme de corporatisme social et national de type
fasciste. C’était une initiative de Jules Romain, un adepte de Jean
Coutrot, fondateur, en 1931, du groupe X crise qui rassemblait des
planistes «polytechniciens». Il est aussi accusé d’avoir dirigé la
Synarchie d’Empire. Le groupe Révolution constructive auquel participa
Marjolin était une caisse de résonance du planisme de de Man. Quant à
Raymond Aron qui, encore en 1983, écrivait : «Traîtres les
collaborateurs, oui ; traîtres les tenants de la Révolution nationale,
certainement non», il avait été un assidu des Décades de Pontigny,
de Paul Dejardins, autre vivier de formation de la technocratie vichyste
entre 1911 et 1939. |