|
"Le Président est évidemment seul à détenir et à déléguer
l’autorité de l’Etat ;l’autorité indivisible de l’Etat est
confiée tout entière au Président par le peuple qui l’a élu,
qu’il n’en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni
militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue par
lui.
Charles de Gaulle, - Conférence de presse du 31 janvier 1964.
Je ne souhaite pas que le président de la République ait
plus de pouvoirs qu’il n’en a déjà. Je propose même qu’il en
ait plutôt moins.
Nicolas Sarkozy, Convention UMP sur les institutions du 5
avril 2006
La France et les sirènes du parlementarisme
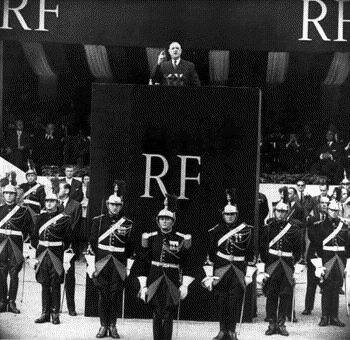 |
Drôle d’anniversaire pour la Ve République ! Le 4
octobre prochain, les corps constitués, peut-être les plus
hautes autorités de l’Etat, fêteront comme si de rien n’était
les cinquante ans des institutions gaulliennes, faisant preuve à
l’occasion d’une belle mauvaise foi et mine d’un unanimisme
joyeux ; il y aura bien ici ou là quelques colloques ou
expositions pour célébrer l’évènement ; le journal télévisé y
consacrera trois minutes, entre les victimes des dernières
inondations et les résultats piteux de ses footballeurs. Notre
vieux pays continuera à faire comme si : comme si la Ve
République existait encore, comme si la France de Sarkozy était
encore celle de De Gaulle, c’est-à-dire tout simplement la
France.
J’entends déjà ceux qui diront que jamais la Ve
République ne s’est si bien portée, qu’avec la dernière
révision, votée par le Congrès réuni à Versailles le 21
juillet dernier, les institutions sont revivifiées,
rajeunies, plus d’attaque que jamais. |
|
Discours de De Gaulle le 4 septembre 1958 place de la
République |
Quelques fortes paroles, quelques
mouvements d’épaules, quelques roulements de mécanique devant un
parterre de notables et de respectables figures, quelques tapes
dans le dos suffiront bien à maintenir l’illusion, mieux
flatteront les souvenirs, au premier rang, de quelques vieux
messieurs du gaullisme. Cela suffira pour inscrire ses petits
pieds dans les pas de géant du Général. Nul ne voudra voir – en
tous les cas nul ne pourra dire – que tout cela est mensonge,
théâtre d’ombres, supercherie et qu’en fait d’anniversaire il
s’agit de prendre acte d’un décès, et pire : que ceux-là mêmes
qui célèbrent l’anniversaire sont ceux qui ont provoqué la mort.
La lente agonie de la Ve République
D’où vient la Ve République ? Il n’est pas inutile
ici de le rappeler. Si la question institutionnelle – en réalité
celle de l’Etat – fut au cœur de la pensée politique de Charles
de Gaulle, c’est que le Général éprouva mieux que d’autres en
1940 la faiblesse congénitale – le parlementarisme – de la IIIe
République ; s’il démissionna en janvier 46, c’est parce qu’il
refusa d’être un jouet dans la main des partis ; s’il jeta le 16
juin 1946 à Bayeux les bases de son projet institutionnel, ce
fut encore contre les conceptions parlementaristes de la IVe
République naissante ; enfin, s’il revint au pouvoir en 1958, ce
fut pour répondre à l’effondrement d’un système institutionnel
miné par les combinaisons partisanes et incapable de résoudre
les difficultés du pays, notamment à l’extérieur. Pendant toutes
ces années, et ensuite lorsqu’il tint les rênes de la France, le
Général ne cessa de marteler combien pour lui l’Etat devrait
être dirigé, et combien, dans ces conditions, le chef de l’Etat
devait être le sommet du dispositif institutionnel. Si le peuple
français approuva par référendum le 22 octobre 1962 le principe
de l’élection du président de la République au suffrage
universel, c’est parce que Charles de Gaulle le voulut ainsi.
Face aux intérêts partisans, au-dessus de la cuisine et des
arrangements politiciens qui sont souvent le lot d’un
parlementarisme débridé, le Général souhaitait dresser la haute
figure de l’Exécutif, de l’homme de la Nation, légitimé par
elle, qui transcende les clivages et incarne cette « puissance
de gouverner » que vantait en son temps le cardinal de
Richelieu. Pour faire court, on disait alors – et les
détracteurs du Général trouvaient dans la formule un argument
supplémentaire contre son gouvernement – que la Ve
République était une « monarchie républicaine ». C’est
exactement ce qu’instituait la constitution gaullienne. Si
l’expression fut créée par Michel Debré, de Gaulle la
reconnaissait volontiers ; à Peyrefitte, il confiait alors : «
Ce que j’ai essayé de faire, c’est d’opérer la synthèse entre la
monarchie et la République [...] une monarchie républicaine. »
Discours de De Gaulle le 4 septembre 1958 place de la
République
On peut dire que ce système fonctionna le temps que dura la
Présidence, c’est-à-dire le gouvernement – car le Général ne
faisait pas la distinction –, de De Gaulle. Mais – et c’est là
la grande faiblesse de la Ve République – comme le
constatait lui-même le Général dans ses Mémoires d’espoir :
« En aucun temps et dans aucun domaine, ce que l’infirmité du
chef a, en soi, d’irrémédiable ne saurait être compensé par la
valeur de l’institution. » Et il est un fait que ses successeurs
ne bénéficièrent pas de « l’équation » propre au Général du fait
de son charisme exceptionnel et de sa légitimité historique. La
Ve République fut donc révisée ou son application
infléchie. Georges Pompidou maintint l’essentiel mais fut un
président clairement marqué à droite ; Valéry Giscard d’Estaing
introduisit en 1974 le droit de saisine parlementaire du Conseil
du constitutionnel, ce qui provoqua l’ire de Michel Debré ;
quant à François Mitterrand, il accepta la cohabitation, brisant
ainsi l’un des principes majeurs des institutions gaulliennes
qui, d’une certaine façon, entendait mettre en pratique la
maxime du grand Corneille lorsqu’il affirmait que « c’est ne pas
régner que d’être deux à régner » Tout cela pourtant n’était
rien en comparaison des quatorze révisions institutionnelles que
Jacques Chirac engagea sous sa présidence, révisions dont la
plus importante fut celle du quinquennat, qui en raccourcissant
le mandat du chef de l’Etat réduisait en même temps sa
légitimité, celui-ci n’étant plus dès lors élu que pour une
durée équivalente à celle d’un simple député.
Contrairement à tout ce qu’on a pu lire et entendre,
contrairement surtout à la propagande absurde de la gauche
socialo-communiste qui fut toujours, depuis l’origine, hostile à
la Ve République et à l’idée de « monarchie
républicaine », Nicolas Sarkozy ne souhaite nullement renforcer
le rôle et la place du chef de l’Etat ; il ne se considère
absolument pas comme, et n’envisage pas d’être, un « monarque
républicain ». Il le voudrait d’ailleurs, que sa nature propre,
tout sauf digne, et son style de gouvernement, tout en clinquant
et en rodomontades sans suite, le lui interdiraient. Non
seulement Nicolas Sarkozy s’inscrit dans la continuité et le
droit fil de cette politique parlementariste mais il procède
avec cette 24ème révision constitutionnelle à un
véritable saut quantitatif dans l’inconnu, refermant selon nous,
sans l’avouer, la longue parenthèse des institutions
gaulliennes. Ségolène Royal, comme son ami Montebourg, voulait
une VIe République ; Nicolas Sarkozy, plus fin
politique et afin de ne pas brusquer son camp, l’a faite sans le
dire, ne sauvegardant que les apparences.
Un manteau d’Arlequin
En fait, pour ceux qui suivent cette affaire avec intérêt, il
n’y a là aucune surprise. Il faut reconnaître cette qualité au
nouveau chef de l’Etat : en la matière, il fait ce qu’il a
promis ; le Président ne fait qu’appliquer le programme du
candidat tel qu’il l’avait annoncé, ou peu s’en faut. Peu
nombreux furent ceux qui lurent en 2007 mon Ils veulent
défaire la France publié à L’Age d’Homme ; la vérité de ce
programme y était écrite noir sur blanc. J’eus beau l’expliquer
à certains miens gaullistes : ils ne m’écoutèrent même pas et
votèrent pour ce candidat-là et pour ce programme-là ;
aujourd’hui ils font encore la sourde oreille et refusent
d’admettre l’évidence. Mais que vaut donc la fidélité à son camp
quand elle consiste à trahir ses propres convictions ?
Je sais bien qu’à chaque nouvelle révision, nous sommes
quelques-uns à crier aux loups et à jurer que c’est la mort des
institutions gaulliennes. Nous l’avons fait au moment de la
cohabitation ; nous l’avons fait quand fut voté le quinquennat.
Aussi a-t-on peut-être du mal à nous croire aujourd’hui quand
nous fustigeons cette 24ème révision. Pourtant, il
faut comprendre que l’agonie de la Ve est un long
processus, que c’est une mort à petit feu, à laquelle on procède
par étapes, sans jamais l’officialiser. Le décès serait plus
simple à entériner si l’on changeait le chiffre, mais on ne
touche pas à de Gaulle aussi facilement, on n’abat pas son œuvre
au grand jour, on ne tourne pas la page aussi ouvertement,
d’autant moins ouvertement qu’on se prétend son héritier, qu’on
s’incline devant sa statue, qu’on inaugure son musée, qu’on
honore sa dépouille pour mieux se hisser dessus. Pourtant, cette
24ème révision est loin d’être anodine, elle est le
coup fatal, le coup de trop, auquel les institutions gaulliennes
ne peuvent résister, dont elles ne se relèveront pas. Avec elle,
c’est la nature même des institutions qui change : les sirènes
du parlementarisme l’ont définitivement emportées et c’est la
fonction exécutive qui est atteinte au cœur. Pour cette
révision, l’essentiel des propositions d’un comité dit de
« modernisation et de rééquilibrage des institutions », comité
que présidait Edouard Balladur et dont Jack Lang était l’un des
vice-présidents – tout est dit ! –, furent retenues. Le rapport
du comité annonçait la couleur : ses trois têtes de chapitre
portaient comme titre : « Un exécutif mieux contrôlé », « Un
parlement renforcé », « Des droits nouveaux pour les citoyens ».
La nouvelle Constitution comporte donc les dispositions
suivantes :
Désormais, le chef de l’Etat ne peut effectuer plus de deux
mandats consécutifs ; le recours au 49-3 est limité à une seule
fois par session, sauf pour le budget et la Sécurité sociale ;
si le chef de l’Etat peut s’exprimer devant le Parlement réuni
en Congrès, un débat sans vote peut avoir lieu à l’issue du
discours ; le Président ne préside plus le Conseil Supérieur de
la Magistrature ; il faut l’autorisation du Parlement pour
prolonger plus de quatre mois une opération militaire à
l’étranger ; l’ordre du jour de l’Assemblée est fixé pour moitié
par les députés eux-mêmes, et lors d’une séance par mois,
l’opposition fixe l’ordre du jour ; le Parlement peut adopter
des résolutions non contraignantes marquant son opinion et
éventuellement défiant la politique suivie ; les textes débattus
sont ceux issus des commissions parlementaires et non plus la
version du gouvernement ; l’opposition bénéficie d’un temps de
parole plus important au Parlement.
Outre ces dispositions profondément hostiles à l’exécutif et
qui, le cas échéant, réduisent ses marges de manœuvre et sa
capacité à gouverner, la révision comporte encore quelques
nouveautés aussi politiquement correctes qu’inutiles ou
dangereuses telles que la reconnaissance des langues régionales,
l’inscription de la parité homme-femme, l’égal accès des hommes
et des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales,
la création d’un défenseur des droits des citoyens, la
constitutionnalisation de l’indépendance, du pluralisme et de la
liberté des médias, toutes mesures qui n’ont pas leur place
normalement dans un texte constitutionnel mais qui sans doute
répondent à la volonté de rendre nos institutions non pas
compatibles mais exactement conformes avec celles de l’Union
européenne, faisant de notre texte fondamental un fourre-tout
indescriptible quand la règle voulait jusqu’alors qu’il fixe
simplement les grands principes et définisse l’organisation des
pouvoirs publics entre eux. Il y a quatre ans, Jean Foyer,
ancien Garde des Sceaux du Général, comparait devant moi la
Constitution à « un manteau d’Arlequin » et avouait qu’il ne
reconnaissait plus dans ce fatras le texte voulu par de Gaulle.
Que dirait-il aujourd’hui ?
Deux autres dispositions nous choquent également. La première
modifie l’article 11 et introduit la mise en place d’un
référendum d’un nouveau type, non pas tant « d’initiative
populaire » comme il est dit, que « d’initiative parlementaire à
soutien populaire » (référendum organisé à l’initiative d’un
cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des
électeurs inscrits sur les listes électorales). Je sais que la
mesure était dans l’air du temps ; cela me semble pourtant une
fausse bonne idée car cette réforme, aux apparences
démocratiques, risque de dénaturer, par le mélange des genres et
la confusion, le caractère initial du référendum tel que
souhaité par le Général, référendum qui, parce que exclusivement
d’initiative présidentielle, sanctionnait – favorablement ou
défavorablement – un choix politique du Président et engageait
sa responsabilité. La seconde disposition est encore plus
sournoise puisqu’elle consiste à modifier les articles 88-5 et
89 du Titre XV « Des Communautés européennes et de l’Union
européenne », articles qui prévoyaient que toute nouvelle
adhésion d’un Etat à l’Union européenne serait
obligatoirement soumise par référendum à l’assentiment du
peuple français, pour considérer désormais qu’une simple motion
adoptée aux 3/5e par les deux chambres autoriserait
le Président à faire entériner cette nouvelle adhésion par voie
parlementaire. Nicolas Sarkozy revient donc sur un engagement
qu’avait inscrit Jacques Chirac dans la Constitution, concernant
notamment l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne.
Vous avez dit « modernisation », « rééquilibrage » ?
Une des seules préconisations du comité Balladur qui n’est pas
suivie dans le texte final concerne évidemment le cumul des
mandats, auquel on ne touche pas. La mesure faisait pourtant
partie du programme de Nicolas Sarkozy ; elle y figurait même en
bonne place, constituant un argument-phare de – comment déjà ? –
« rupture ». Il est vrai que 85% des parlementaires sont des
cumulards et que la galette est visiblement bonne. Mieux,
désormais les ministres issus du Parlement retrouveront
automatiquement leur siège en cas de démission ou de renvoi.
Les points-clés de la réforme sont donc clairement en faveur
d’une parlementarisation accrue du régime ; ils prennent le
contre-pied de l’esprit et de la lettre de la Ve
République ; pour dire vrai, après la cohabitation, après le
quinquennat, ce renforcement des pouvoirs de contrôle du
Parlement, cette dévalorisation de la place du Président, met à
bas l’édifice gaullien.
Présentation du rapport du Comité Balladur
A ceux qui en doutent encore, crient à l’hyper présidentialisme,
ou refusent de voir l’évidence, répétons les mots mêmes du père
de la réforme, Edouard Balladur : « Ce qui a été retenu est ce
qui était essentiel à mes yeux, à savoir une limitation des
pouvoirs du président de la République, un renforcement de ceux
du Parlement [...]. Dire que la révision constitutionnelle crée
une monocratie présidentielle est tout simplement une
absurdité. » Le Premier ministre ne cache pas non plus la
réalité d’une réforme qu’il a appuyée et qui, dixit, « va
compliquer la vie du gouvernement et renforcer le Parlement ».
C’est là une première dans l’histoire de France : un
gouvernement défend un projet dont l’adoption même lui
compliquera la vie ! Autant d’emblée, cher François Fillon, vous
tirez une balle dans le pied ! L’affaire est grave, d’autant
plus qu’on sait qu’elle aura une suite, que d’autres réformes du
même type sont dans les tuyaux, comme la prise en compte du
temps de parole du Président comptabilisé comme temps du parti
majoritaire, la réforme du Sénat et l’introduction d’une dose de
proportionnelle, promesse de campagne du candidat Sarkozy. Le
journaliste Guillaume Tabard s’en félicite bêtement dans le
Figaro du 21 juillet : « Le mouvement ne va pas s’arrêter.
C’est un des mérites de la méthode Sarkozy : elle a stimulé
l’imagination et poussé tous les acteurs politiques à entretenir
ou relancer leur réflexion sur les questions
institutionnelles. » Et voilà qu’on évoque depuis plusieurs mois
la création d’une prochaine commission, présidée cette fois par
Simone Veil, qui serait chargée de faire des propositions pour
modifier le Préambule de la Constitution.
On dit « modernisation ». Nicolas Sarkozy le premier lorsqu’il
se félicite de l’adoption de la réforme : « C’est une victoire
pour la démocratie française, je m’en réjouis
profondément. [...] Une fois de plus, le camp du mouvement, du
changement, de la modernité l’a emporté sur le camp de
l’immobilisme, de la rigidité et du sectarisme. » L’argument est
convenu pour faire passer la pilule ou avaler la couleuvre ; on
le ressort à chaque fois qu’il s’agit de défaire un peu plus ce
qui fonctionnait et qui faisait la France. Il est assez cocasse
de constater que c’est la droite qui se veut désormais
« moderne », et a plein la bouche ce mot de « modernité »,
sésame de la "bien-pensance". On dit encore « rééquilibrage »,
mais il n’y a pas à « rééquilibrer » les pouvoirs, entre
exécutif et législatif. D’où vient cette manie à tout vouloir
toujours, à droite aussi bien qu’à gauche, « rééquilibrer » ou
« égaliser », comme si tout devait forcément valoir tout, comme
si tout devait être arasé, nivelé, comme si rien ne devait être
prééminent, au-dessus, supérieur, comme s’il fallait que l’élève
équivale le maître, que le tag soit une œuvre d’art, que le
"pipole" remplace le politique, et que donc le chef de l’Etat ne
soit qu’un élu comme les autres.
Oui, les institutions de la Ve République étaient
déséquilibrées au profit du chef de l’Etat, de qui tout
procédait, et d’abord le gouvernement. Mais c’était bien ainsi.
C’est ainsi, figurez-vous, qu’on gouverne. Le commandement ne se
divise, pas davantage que la souveraineté, et si en démocratie
les pouvoirs doivent être séparés, pourquoi devraient-ils être
équilibrés ?
Le parti plutôt que le pays
Ironie
de l’Histoire : le 21 juillet dernier, la révision fut adoptée à
une seule voix de majorité puisque 539 parlementaires
l’approuvèrent quand était requis 538 suffrages, les 3/5e
des voix exprimées. On fit grand cas alors du choix de Jack
Lang, lequel approuva le texte contre l’avis du parti socialiste
et de tous ses parlementaires. Le député UMP de l’Hérault,
Jean-Pierre Grand, l’un des rares à s’opposer jusqu’au bout à
la révision, eut une heureuse formule en évoquant « la
constitution de Jack Lang », ce qui traduisait ni plus ni moins
que la vérité, le député du Pas-de-Calais ayant non seulement
voté le texte mais aussi contribué de longue date à l’inspirer
par ses réflexions. Faut-il rappeler par exemple que dans
l’ouvrage Un nouveau régime politique pour la France,
publié en 2004, ce dernier considérait la Ve
République comme « un néo bonapartisme d’un autre âge » et se
glorifiait d’être « en rébellion contre nos institutions dès
1958 », dénonçant au passage « le pouvoir hautain de Charles de
Gaulle » qui plaça le régime « sous sa baguette» ! Il est
savoureux après cela d’entendre le porte-parole de l’UMP saluer
« l’honnêteté intellectuelle » de Jack Lang.
Mais à une voix de majorité, cette nouvelle Constitution, qui
n’ose pas encore s’appeler VIe République, n’est pas
seulement celle de Jack Lang ; elle est aussi celle de tous
ceux, pris individuellement, qui la votèrent. Finalement, une
voix de majorité – l’histoire de France connaît cela –, c’est le
scénario idéal : chacun de ceux qui vote la mort est ainsi mis
en face de ses responsabilités et doit assumer personnellement
son choix sans pouvoir se noyer dans la masse. Aussi cette
nouvelle Constitution est-elle également celle de Bernard Debré,
fils de Michel, qui malgré son opposition au texte le vota en
définitive, déclarant pour se justifier qu’il ne voulait pas
s’associer aux socialistes, qu’il fallait serrer les rangs
derrière le président de la République pour ne pas l’affaiblir
dans sa politique intérieure et extérieure, préférant ainsi –
c’est bien triste de la part d’un homme que nous estimions – son
parti à son pays. Exactement l’attitude qu’adoptèrent les
députés Hervé Mariton et Georges Tron qui, finalement ralliés,
se fendirent d’une tribune dans Le Figaro pour se
justifier : « Notre opinion n’a pas changé sur le fond mais cela
ne vaut pas la peine de mettre un pataquès dans la majorité. »
Cette nouvelle Constitution – autre souffrance – c’est encore
celle de Charles Pasqua qui malgré ses foucades, l’approuva
après s’être fait prié. Cette nouvelle Constitution, c’est enfin
celle de Patrick Labaune, député de la Drôme, et de
François-Xavier Villain, député du Nord, respectivement
vice-président et membre du Conseil d’administration de
Debout la République, qui votèrent le texte pendant que
Nicolas Dupont-Aignan, député de l’Essonne et président de leur
mouvement, faisait hautement savoir qu’il s’y opposait,
démontrant une fois de plus, si besoin était, que la vérité de
DLR est plus beaucoup plus ambiguë qu’il n’y paraît. Oui, une
voix de majorité, cela responsabilise et ne peut mentir.
Au contraire, il faut saluer ceux qui résistèrent aux sirènes du
parlementarisme et aux menaces de basse politique. Tels les sept
courageux de l’UMP, messieurs Henri Cuq, Guy Geoffroy, François
Goulard, Jean-Pierre Grand, Jacques Le Guen, André Lardeux et
Jacques Myard. Tels aussi les cinq parlementaires du MPF de
Philippe de Villiers : Véronique Besse, Dominique Souchet,
Bernard Seillier, Philippe Darniche et Bruno Retailleau. Ceux-là
choisirent leurs convictions plutôt que leurs carrières, cela
mérite d’être remarqué : ils ne furent pas si nombreux. Du
courage et des convictions, il en fallut en effet quand on sait
à quel harcèlement ces parlementaires furent soumis, subissant
les incessants appels téléphoniques qui du secrétaire d’Etat à
l’Intérieur et aux Collectivités Territoriales, lequel laissait
entendre que le futur redécoupage électoral pourrait être
défavorable aux réfractaires, qui du président de l’Assemblée
nationale, lequel proposait en échange d’un ralliement quelques
missions rémunérées, qui enfin – c’est stupéfiant – du
président de la République lui-même lequel maniait à son tour la
carotte et le bâton. Nous nageons déjà en pleine IVe
République, le temps est revenu des combinazione en tous
genres.
Tout cela évidemment se fait dans le dos des Français dont
d’opportuns sondages nous expliquent qu’il l’approuve, 86%
d’entre eux étant par exemple favorable à la limitation du
nombre de mandats présidentiels à deux. La belle affaire quand à
ces pauvres Français on n’explique pas la réalité derrière les
apparences et qu’eux-mêmes s’en moquent ou ne comprennent rien à
ces questions.
Mais il y a sans doute une cohérence cachée à cette marche
forcée vers le parlementarisme : celle qui consiste à affaiblir
l’exécutif français au moment où l’on veut renforcer celui de
l’Union européenne. Pour preuve, cette troublante image
télévisuelle des dernières semaines : lorsque Nicolas Sarkozy
recevait à l’Elysée un homologue étranger – ce fut le cas par
exemple avec le président ukrainien – se tenait à ses côtés José
Manuel Barosso, le président de la Commission européenne, qui
semblait le véritable maître du château. Au point que le
téléspectateur pouvait se demander s’il n’avait pas la berlue et
si la photo sur le perron n’était pas cruellement signifiante,
si la France n’avait pas désormais deux présidents, pire : si
Nicolas Sarkozy n’était pas tant le président en exercice de
l’Union européenne qu’un simple gouverneur de province et si
José Manuel Barosso n’était pas en fait le véritable chef de
l’Etat. Nul ne doit en douter : la mise à mort de la Ve
République et la parlementarisation des institutions françaises
ne servira pas la France. |